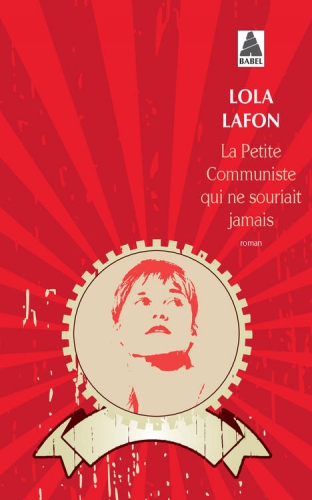
JO de Montréal 1976. Le monde entier a les yeux rivés sur la très jeune Nadia Comaneci, prodige de la gymnastique roumaine. Elle vient de réaliser un parcours sans faute, tellement parfait que les écrans s'affolent, affichent un 1, 00 au lieu d'un 10, note normalement impossible à obtenir dans la discipline. L'univers entier découvre la perfection, en même temps que l'existence de cet obscur pays communiste, satellite de l'URSS, qui sait si bien préparer ses athlètes, les former dès le berceau.
C'est un exercice vraiment troublant et fascinant auquel se livre Lola Lafon dans ce roman. La narratrice y est en lien avec Nadia Comaneci car elle cherche à écrire sa biographie. Pourtant l'imaginaire se taille la part du roi dans ce texte, bâti autour de documents vidéo, témoignages d'époques, certes, mais en s'en inspirant très librement. Le lecteur s'embrouille : qui est l'auteur ? Qui est le narrateur ? Quel est la part de fiction dans ce récit ? Pour finalement se laisser aller.
La performance de Lola Lafon ici, c'est d'intéresser des lecteurs à une gymnaste, mais au-delà à un pays. Les Ceaucescu feront en effet bien sûr de la jeune fille un outil de communication imparable aux yeux du monde, pour la dissimuler ensuite lorsqu'elle prendra trop de place. Son parcours semble calquer celui du bloc de l'est. Elle quittera d'ailleurs le Roumanie quelques semaines à peine avant la chute du terrible couple de souverains rouges, dont les images des corps éxécutés hantent la mémoire collective du Noël 1989.
Il est question de Nadia et d'exercices à la poutre, mais aussi d'écoutes téléphoniques, de denrées en polystyrène dans les vitrines des magasins, de gratuité de la scolarité, d'excellence, et de jugements à l'emporte-pièce de ceux de l'ouest. Une biographie fictive, documentée et vraisemblable qui retrace les 25 dernières années de la Roumanie communiste. Très réussi.
La petite communiste qui ne souriait jamais, Lola Lafon (France).
Babel. 320 pages. 8, 70 €
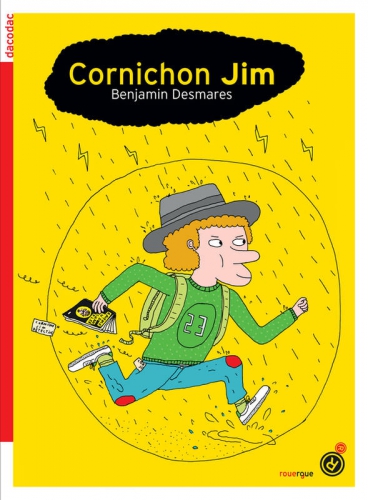
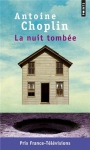 Partir en moto sur les routes, avec une remorque harnachée derrière, c'est déjà une aventure en soi. Le faire pour rejoindre Pripiat, quelques années après l'accident de Tchernobyl, cela relève forcément de la nécessité absolue. Gouri a un besoin impérieux de retourner là-bas, dans la zone contaminée. Pour ramener quelque chose qui lui appartient, qui est resté dans son appartement. Un objet un peu incongru mais plein de sens pour lui. Les immeubles ont tous été pillés, il lui faudra un peu de chance pour retrouver ce qu'il cherche. De la chance, il lui en faudra aussi pour passer sans encombre les barrages. De la compagnie bienveillante également pour mener son projet à bien.
Partir en moto sur les routes, avec une remorque harnachée derrière, c'est déjà une aventure en soi. Le faire pour rejoindre Pripiat, quelques années après l'accident de Tchernobyl, cela relève forcément de la nécessité absolue. Gouri a un besoin impérieux de retourner là-bas, dans la zone contaminée. Pour ramener quelque chose qui lui appartient, qui est resté dans son appartement. Un objet un peu incongru mais plein de sens pour lui. Les immeubles ont tous été pillés, il lui faudra un peu de chance pour retrouver ce qu'il cherche. De la chance, il lui en faudra aussi pour passer sans encombre les barrages. De la compagnie bienveillante également pour mener son projet à bien. Emilienne et la narratrice sont des amies, des vraies. Elles partagent la même expérience de la vie, qui semble les souder à jamais, sans que cela ait besoin d'être formulé. Elles sont jeunes. Rien ne prédispose donc Emilienne à s'effondrer en pleine journée, en buvant un chocolat chaud dans un bistrot avec le jeune garçon étranger qu'elle aide à faire ses devoirs. Le coeur bat. Et puis il s'arrête. Comme ça.
Emilienne et la narratrice sont des amies, des vraies. Elles partagent la même expérience de la vie, qui semble les souder à jamais, sans que cela ait besoin d'être formulé. Elles sont jeunes. Rien ne prédispose donc Emilienne à s'effondrer en pleine journée, en buvant un chocolat chaud dans un bistrot avec le jeune garçon étranger qu'elle aide à faire ses devoirs. Le coeur bat. Et puis il s'arrête. Comme ça.
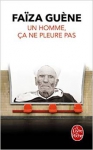 S'émanciper : "s'affranchir d'une tutelle, d'une sujétion, de servitudes", nous révèle le Robert. Nulle mention de la famille dans cette définition. C'est de cette émancipation-là dont choisit quant à elle de nous parler Faïza Guène. Car il est bien question de cordons ombilicaux à rompre dans Un homme, ça ne pleure pas.
S'émanciper : "s'affranchir d'une tutelle, d'une sujétion, de servitudes", nous révèle le Robert. Nulle mention de la famille dans cette définition. C'est de cette émancipation-là dont choisit quant à elle de nous parler Faïza Guène. Car il est bien question de cordons ombilicaux à rompre dans Un homme, ça ne pleure pas. Mener un travail autobiographique par l'angle exclusif du corps, ses évolutions, ses déchirements, ses cicatrices, ses résurrections : voilà l'enjeu audacieux de ce roman. Périlleux, même, pourrait-on croire à la lecture des premières pages. Et puis petit à petit, on se rend compte que non, car finalement, quel meilleur témoin des vies que ces enveloppes charnelles, invisibles, douloureuses, gratifiantes ou inquiétantes ?
Mener un travail autobiographique par l'angle exclusif du corps, ses évolutions, ses déchirements, ses cicatrices, ses résurrections : voilà l'enjeu audacieux de ce roman. Périlleux, même, pourrait-on croire à la lecture des premières pages. Et puis petit à petit, on se rend compte que non, car finalement, quel meilleur témoin des vies que ces enveloppes charnelles, invisibles, douloureuses, gratifiantes ou inquiétantes ?