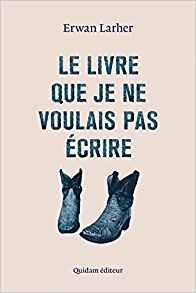
Lui ne voulait pas l'écrire. Nous, pas sûrs que nous voulions le lire. Et pourtant il est là, ce livre. Qui n'est pas un roman, mais un récit. Celui d'une soirée d'hiver pendant laquelle un fan de rock se rend à un concert, dans l'attente de la communion qui a toujours lieu dans ces cas-là. Sauf que ce jour d'hiver, c'est le 13 novembre 2015. Sauf que cette salle de concert, c'est le Bataclan.
Bien sûr qu'il avait surtout des raisons de ne pas l'écrire, ce texte, cet "objet littéraire", Erwan Lahrer. Parce qu'il était un survivant, parce qu'il ne se sentait pas un héros, parce qu'il était hanté par le portrait de ceux qui sont morts ce soir-là. Parce qu'il avait un corps à reconstruire. Parce qu'il faudrait assurer le service après-vente du livre, répondre aux questions des journalistes. Parce qu'il faudrait trouver le ton juste. Parce que sur son chevet d'hôpital, il y avait déjà les épreuves d'un roman sur le point de sortir. Parce que la pudeur, parce que la dignité, parce que le choc. Parce que le "je", ça n'allait pas. Parce que le "il", ça n'allait pas.
La pression amicale des proches, amis auteurs notamment, aura eu raison de cette détermination, de cette peur de passer pour un charognard. Tous les moments de ce récit sautent à la gorge, tous, mais la pudeur de son auteur semble déteindre sur nous, lecteurs. On n'est pas là pour voir des scènes de guerre avec un oeil avide. Souvent, on a même refusé d'apercevoir le moindre plan à la télé. On ne sait pas trop, vraiment, pourquoi on est en train de lire ces lignes. Mais on sait que les lire nous fait du bien.
Les mots des proches d'Erwan Larher s'intercalent entre les chapitres de l'auteur pour raconter leur soirée du 13 novembre à eux. Comment ils ont réagi, stupeur exprimée de mille façons différentes. Parce que tous savaient où il était ce soir là, il l'avait annoncé sur Facebook avec fierté dans la journée. Ces mots là, aussi, nous parlent. Ceux des spectateurs impuissants que nous étions tous.
Les questions sur la peur qui reste en suspens dans l'atmosphère et qui culpabilise, aussi, nous évoquent quelque chose, à tous. Alors, même s'il avait surtout des raisons de ne pas exister, c'est une très belle chose que ce livre existe.
Le livre que je ne voulais pas écrire, Erwan Lahrer (France). 260 pages. Quidam éditeur. 20 €
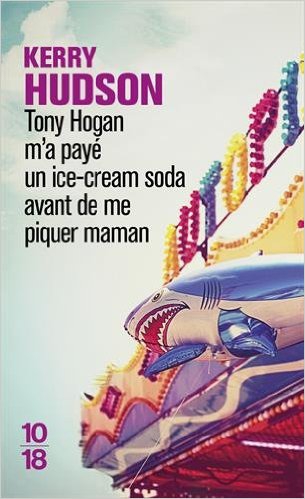
 On connaît le bonhomme et sa silhouette bancale. Ses textes fins et sa voix fantomatique. On le connaît derrière un micro, aimé ou brocardé, auteur de textes courts et percutants. Le voilà aux commandes d'un format différent : 165 pages de retour sur soi, de confessions, de révélations intimes sur une exprérience fondatrice : l'accident, l'hospitalisation, le handicap, la rééducation. La découverte brutale et complètement inattendue, à 19 ans, d'un monde dont les valides ne connaissent que les contours, les parties émergées.
On connaît le bonhomme et sa silhouette bancale. Ses textes fins et sa voix fantomatique. On le connaît derrière un micro, aimé ou brocardé, auteur de textes courts et percutants. Le voilà aux commandes d'un format différent : 165 pages de retour sur soi, de confessions, de révélations intimes sur une exprérience fondatrice : l'accident, l'hospitalisation, le handicap, la rééducation. La découverte brutale et complètement inattendue, à 19 ans, d'un monde dont les valides ne connaissent que les contours, les parties émergées. Comment écrire une autobiographie en effleurant juste les personnes et les événements ? Comment exprimer de l'amertume par rapport à son enfance quand celle-ci n'a pas été le théâtre de drames ou de désamours ? Dominique Ané choisit d'évoquer les lieux, juste les lieux. Des lieux boule au ventre, ceux où il a grandi. Pas de misère, pas d'insalubrité, loin s'en faut, mais un sentiment d'isolement, de morne plaine autour de la cité historique de Provins. Alors quand Dominique Ané sera devenu Dominique A., le parolier que l'on connaît pour avoir apporté un souffle nouveau dans la chanson française au milieu des années 90, quand les années auront passé, quand il aura mis cap à l'ouest, il y repensera à cette ville.
Comment écrire une autobiographie en effleurant juste les personnes et les événements ? Comment exprimer de l'amertume par rapport à son enfance quand celle-ci n'a pas été le théâtre de drames ou de désamours ? Dominique Ané choisit d'évoquer les lieux, juste les lieux. Des lieux boule au ventre, ceux où il a grandi. Pas de misère, pas d'insalubrité, loin s'en faut, mais un sentiment d'isolement, de morne plaine autour de la cité historique de Provins. Alors quand Dominique Ané sera devenu Dominique A., le parolier que l'on connaît pour avoir apporté un souffle nouveau dans la chanson française au milieu des années 90, quand les années auront passé, quand il aura mis cap à l'ouest, il y repensera à cette ville.  Dans
Dans 
